Auteur/autrice : Emmanuel Poirault


Résultats de l'appel à projets 2022 Bis
Liste des projets sélectionnés.Comité scientifique
Julie Amiot-Guillouet (CY)
Étienne Anheim (EHESS)
Grégory Delaplace (EPHE)
Anne-Julie Etter (CY, FSP)
Christian Hottin (EUR HCP)
Nathalie Koble (ENS)
Chantal Lapeyre (CY)
Christine Laurière (CNRS)
Sandie Le Conte (!NP)
Anne Lehoorff (CY)
Olivier Zeder (!NP)
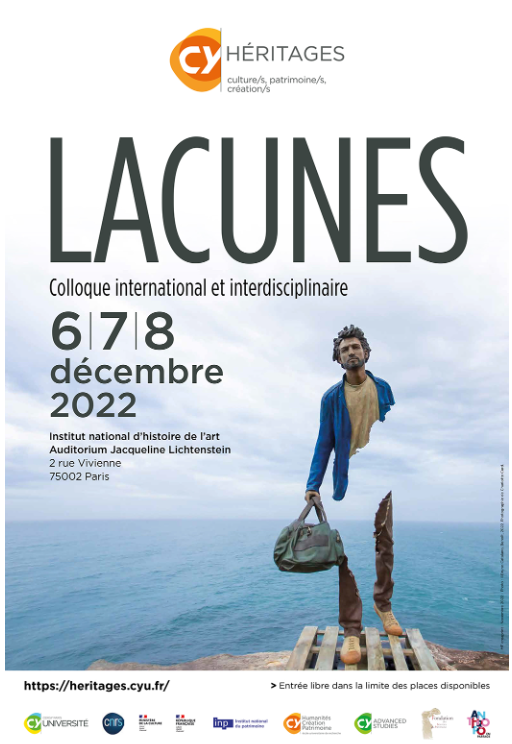
Résumé :
L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés fait partie des grands monastères bénédictins parisiens qui disposent d’un riche ensemble de documents médiévaux produits entre les IXe et XVe siècles et aujourd’hui conservés aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France. À partir de leur examen, l’objectif de ce travail est de montrer : 1) comment les moines sont amenés au cours de deux épisodes de réforme à la fin du XIIe siècle et à partir du milieu du XIIIe siècle à inscrire l’écrit dans l’ensemble des pratiques sociales qui garantissent la stabilité institutionnelle de la communauté et 2) comment ces pratiques d’écriture font évoluer en profondeur les fondements du pouvoir monastique.
Le premier moment consiste en la rédaction du premier cartulaire de Saint-Germain-des-Prés encore conservé à la fin du XIIe siècle. Aboutissement d’un long moment d’écriture de l’histoire à Saint-Germain qui a débuté dès le IXe siècle, cette cartularisation souligne un désir de maîtrise par l’écrit de la mémoire de l’institution qui se formalise en un véritable récit historique patrimonial. Cet épisode pose la question du rôle que l’écrit joue dans les processus de contrôle des hommes et des femmes, de territorialisation graduelle du pouvoir monastique et de mutation de l’autorité abbatiale.
Le second moment de notre enquête est consacré à un tournant documentaire qui survient au cours de la seconde moitié du XIII e siècle et laisse des
effets jusqu’au début du XV e siècle. L’écrit devient un élément incontournable du paysage institutionnel. Cette irruption engendre des reconfigurations des fondements de la domination monastique qui participent de la constitution d’un nouveau modèle d’équilibre gouvernemental.
The abbey of Saint-Germain-des-Prés is one of the great Parisian Benedictine monasteries with a rich collection of medieval documents, written between the 9th to the 15th Centuries and now preserved in the National Archives and the National Library of France. The objective of this work is, by examining those documents, to show : 1) how the monks were led during two episodes of reform at the end of the 12th century and from the middle of the 13th century onwards to include writing in the set of social practices that guaranteed the institutional stability of the community and 2) how do these writing practices profoundly change the foundations of monastic power?
A first important event is the writing of the first cartulary of Saint-Germain-des-Prés, which is still preserved today at the end of the twelfth century. As the culmination of a long period of writing history at Saint-Germain that began in the ninth century and the result of the patrimonial recovery that began in the eleventh century, this first cartularization underlines a strong wish to establish the memory of the institution through writing, formalized into a true historical patrimonial narrative. This episode raises the question of the role that the written word plays in the processes of control of men and women, the gradual territorialization of monastic power and the mutation of abbatial authority.
The second important event is a major turning point in documentation that takes root in the middle of the thirteenth century, underlining and actively participating in a profound institutional reconfiguration over the long term until the beginning of the 15th century. The written word becomes an indispensable tool for the institution. This major irruption led to reconfigurations of the foundations of monastic domination, which contributed to the constitution of a new model of governmental equilibrium.
Composition du jury :
- Pierre CHASTANG, professeur, Université Paris-Saclay, UVSQ (directeur de thèse)
- Adam KOSTO, professeur, Université de Columbia (co-directeur de thèse)
- Pierre JUGIE, conservateur général du patrimoine, Archives nationales (co-encadrant de thèse)
M. Paul BERTRAND, professeur, Université Catholique de Louvain (rapporteur et examinateur) - Florian MAZEL, professeur, Université Rennes 2 (rapporteur et examinateur)
- Laurent FELLER, professeur, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (examinateur)
- Mme Valérie THEIS, professeure, École Normale Supérieure Ulm (examinatrice)
- Mme Maaike VAN DER LUGT, professeure, Université Paris-Saclay, UVSQ (examinatrice)
